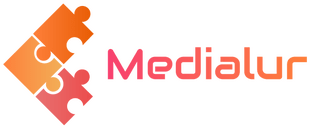Sofia ouvrit lentement les yeux, encore enveloppée dans cette torpeur épaisse du matin, cette demi-conscience paresseuse qui refusait obstinément уступить место au jour naissant. Derrière la cloison, dans la cuisine, monta un bruit familier, presque rassurant : celui de la bouilloire qui commençait à siffler. Son cri aigu et pressant déchira le silence de l’appartement, comme un signal annonçant le début d’un nouveau rituel monotone.
Au-dehors, dans la brume grise, l’aube d’octobre tentait vainement de percer la couverture compacte des nuages. Trois longs mois déjà s’étaient écoulés depuis que Sofia vivait entre ces murs — trois mois de matins semblables, rythmés par les mêmes gestes et les mêmes sons. Vera Petrovna, sa belle-mère, était toujours debout avant tout le monde : ses pas précis résonnaient dans le couloir, et son regard, froid et méthodique, inspectait chaque recoin, chaque grain de poussière, avec cette infaillible assurance des maîtresses de maison qui se savent seules souveraines sur leur territoire.
Le déménagement en ville avait pourtant longtemps semblé à Sofia le commencement d’une vie nouvelle, lumineuse. Un poste de gestionnaire dans un grand supermarché, la promesse de reprendre ses études, la proximité retrouvée avec son mari — tout cela dessinait une image attrayante d’avenir, pleine d’espoir et de renouveau. Le village natal, avec ses chemins de terre, le tintement du seau au puits et l’habitude de se coucher au rythme du soleil, appartenait déjà à un autre monde. Ici, dans un appartement de trois pièces au cinquième étage d’un immeuble gris et sans charme, la vie obéissait à des règles nouvelles, strictes et étrangères.
Mark, son mari, l’avait pourtant prévenue : « Maman est quelqu’un de… particulier. » Il l’avait dit d’un ton léger, presque distrait, comme s’il évoquait un petit travers sans importance — une passion pour l’ordre ou une manie de se lever avant l’aube. Sofia, alors, s’était contentée de sourire. Elle était sûre d’elle : il lui suffirait de faire preuve de douceur, de patience, de bonne volonté. Après tout, une belle-mère, c’est juste une autre personne avec qui il faut apprendre à s’entendre, trouver un langage commun.
Mais la réalité s’était révélée bien plus âpre.
Vera Petrovna avait accueilli sa belle-fille avec une politesse distante, cette froideur soigneusement dosée qu’on réserve aux invités qu’on ne souhaite pas voir s’attarder. Sa poignée de main avait été sèche, brève. Son regard glissa sur Sofia, de sa vieille veste passée à ses baskets usées, avant de s’arrêter un instant sur son visage avec une expression où l’on devinait davantage la réserve que la bienveillance.
— Eh bien, entre, installe-toi, dit-elle simplement, avant de se retourner et de s’éloigner dans le couloir sans attendre de réponse.
Mark, silencieux, prit les sacs lourds, croisa un instant le regard de sa femme — un regard où il tenta d’y glisser un peu d’encouragement — puis lui indiqua leur chambre. La maison les accueillit dans un calme creux, presque sonore, imprégné d’odeur de cire et de linge fraîchement repassé.
Les premiers jours furent faits de maladresse et de tension, d’efforts pour s’adapter, trouver sa place, apprivoiser le nouveau rythme. Sofia se levait avant tout le monde, s’appliquait à aider, préparait le dîner, demandait chaque soir s’il fallait rapporter quelque chose. Vera Petrovna acceptait cette aide sans un mot, parfois d’un bref signe de tête, mais bien plus souvent elle reprenait tout, silencieuse, méthodique, comme pour rétablir l’ordre légitime des choses.
— Les assiettes doivent se ranger sur cette étagère, pas ailleurs, disait-elle en les déplaçant. Et la serpillière, après avoir lavé le sol, il faut toujours la suspendre sur le balcon pour sécher, jamais la laisser dans la salle de bain.
Sofia opinait, notait tout mentalement, s’efforçait de bien faire. Mais les règles étaient innombrables, mouvantes, surgissant à tout moment, comme pour la mettre à l’épreuve, tester sa patience et sa résistance.
Le travail au supermarché devint alors pour elle une bouffée d’air. Là, au moins, elle se sentait utile, à sa place. Elle contrôlait les livraisons, vérifiait les dates, remplissait les rapports. Ses collègues l’appréciaient, ses supérieurs la respectaient. Huit heures passaient en un éclair — et le simple fait de rentrer chez elle faisait naître en elle un poids, un nœud sombre au creux de la poitrine.
Mark travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise du bâtiment. Il rentrait tard, épuisé, mangeait sans un mot et se retirait dans leur chambre. Sofia comprenait : son métier était exigeant. Mais plus les jours passaient, plus elle ressentait douloureusement l’absence de son soutien, de ce mot ferme et protecteur qui aurait pu la défendre face aux piques de sa mère.
Le premier coup véritable vint un soir, lors d’un dîner où Vera Petrovna avait invité une vieille amie — Zinaïda Ilitchna, une femme d’une soixantaine d’années, à la voix puissante et aux manières autoritaires.
— Alors c’est elle, ta belle-fille ? demanda la visiteuse avec une curiosité appuyée, détaillant Sofia de haut en bas.
— Oui, Sofia, répondit la belle-mère d’un ton neutre avant d’ajouter, avec un mince sourire : Elle vient de la campagne. Une fille simple, sans prétention. Elle s’adapte encore à la vie d’ici.
Zinaïda hocha la tête d’un air entendu.
— Oh, mais c’est bien, ça. L’important, c’est qu’elle soit travailleuse. Le reste viendra.
Sofia baissa les yeux, découpant son pain avec une précision mécanique, tâchant de ne pas montrer la brûlure qui lui montait aux joues. Mark, lui, gardait le silence. Vera Petrovna, impassible, poursuivait la conversation comme si de rien n’était.

Depuis ce soir-là, les remarques de ce genre se multiplièrent, fines, déguisées sous une apparente bienveillance :
— Ma chère, tu devrais te coiffer autrement : on dirait que tu reviens du champ !
— Cette jupe ne te met pas en valeur, elle te donne un air… provincial.
— Tu as encore un léger accent, ma douce. Peut-être devrais-tu lire des livres un peu plus relevés, ça t’aiderait à affiner ton langage.
Chaque mot tombait comme une goutte acide sur la peau. Sofia encaissait, sans répondre. Toute tentative de justification se serait retournée contre elle : Vera Petrovna avait ce talent rare de transformer chaque reproche en preuve de sollicitude, chaque blessure en conseil maternel.
Un soir, alors que Mark était sorti à une réunion de travail, la voix de la belle-mère l’appela depuis la cuisine.
— Viens t’asseoir, il faut que nous parlions.
Sofia s’installa prudemment en face d’elle. Vera Petrovna touillait son thé avec lenteur.
— Je veux que tu comprennes une chose, dit-elle enfin d’un ton mesuré. Mark est mon fils unique. Je l’ai élevé seule, j’ai tout sacrifié pour lui : mon temps, ma vie, mes forces. Et aujourd’hui, je vois bien que tu fais des efforts… Mais crois-moi, ma fille, les efforts, à eux seuls, ne suffisent pas.
— Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, murmura Sofia d’une voix presque éteinte.
— Tu viens d’un tout autre monde, Sofia. Tu es une fille de la campagne, habituée à une vie simple, sans prétention. Ici, en ville, tout est différent : les exigences, le rythme, le niveau de vie. Et si tu veux vraiment être auprès de mon fils, il te faudra te surpasser sans cesse, t’élever, t’adapter. Autrement… enfin, je crois que tu comprends très bien ce que je veux dire.
Véra Petrovna se tut, mais son regard lourd, perçant, en disait plus long que ses mots.
Sofia avala avec difficulté — non pas une larme, mais un nœud qui s’était formé dans sa gorge, si sèche soudain que les mots semblaient s’y être figés, incapables d’en sortir. Véra Petrovna se leva lentement, prit sa tasse, et quitta la cuisine sans un mot, laissant Sofia seule sous la lumière froide de la lampe suspendue.
Les jours passèrent, et l’atmosphère de la maison devint de plus en plus pesante, oppressante. Véra Petrovna ne cherchait même plus à dissimuler son mépris. Les piques et remarques acerbes fusaient à tout propos : la soupe manquait de sel, le sol était mal lavé, Sofia parlait trop fort, trop vivement au téléphone avec ses parents.
Marc, lui, restait silencieux. Sofia voyait bien la tension crispant ses traits chaque fois que sa mère lançait une de ses tirades, mais jamais un mot ne venait rompre ce silence pesant. Une fois, alors que Véra Petrovna venait de lâcher avec une acidité particulière que Sofia « ne savait pas se tenir en société », Marc s’était simplement levé et était allé fumer sur le balcon.
Sofia l’avait rejoint, la gorge serrée.
— Marc, pourquoi tu te tais toujours ? demanda-t-elle d’une voix tremblante.
Son mari tira longuement sur sa cigarette, avant d’expirer lentement une volute de fumée dans l’air glacé.
— Sofia, tu sais comment est ma mère. Elle a un caractère… compliqué. Essaie simplement de ne pas y prêter attention. Laisse couler.
— Mais comment veux-tu que je n’y prête pas attention ? Elle me parle comme ça tous les jours ! s’écria-t-elle, la voix brisée par les larmes.
— Et que veux-tu que je fasse ? Que je me mette à hurler ? Ça ne servirait à rien, tu le sais. Ma mère a toujours pensé qu’elle seule savait comment tout doit être fait. Laisse le temps passer. Elle finira bien par se calmer.
Il écrasa sa cigarette, évita le regard de sa femme et rentra dans l’appartement.
Sofia resta dehors, immobile sur le balcon, face aux innombrables lumières de la ville. En bas, le flot continu des voitures bourdonnait, un chien aboyait au loin, le vent d’automne secouait les feuilles jaunies. Le froid s’infiltrait dans sa fine chemise, mais rentrer, retourner là-dedans, lui était insupportable.
Le point de rupture survint un samedi soir. Marc était rentré un peu plus tôt, et toute la famille s’était réunie autour de la grande table. Sofia avait préparé un ragoût de pommes de terre et de légumes selon une vieille recette de sa grand-mère. Véra Petrovna goûta une bouchée, puis son visage se crispa de déplaisir.
— Encore ta cuisine de paysanne… trop simple, constata-t-elle avec dédain. La viande est dure, les pommes de terre sont trop cuites. On ne prépare pas ainsi un repas dans une maison respectable.
Sofia serra les poings sous la table, sentant la chaleur lui monter au visage.
— J’ai fait comme on m’a appris, répondit-elle calmement, les yeux fixés sur sa belle-mère.
— Justement, voilà le problème, ricana Véra Petrovna. Tu ne sais cuisiner que « façon campagne », sans raffinement. Ici, il faut savoir préparer des plats pour des gens cultivés, pas pour des bêtes de ferme.
Marc releva brusquement la tête et planta son regard dans celui de sa mère.
— Maman, ça suffit maintenant.
— Comment ça, « ça suffit » ? Je ne fais que dire la vérité. Tu vois bien, toi aussi, qu’elle…
— J’ai dit : assez.
Véra Petrovna leva les mains d’un air excédé et se leva lentement.
— Très bien, je me tairai. Mais ne viens pas dire ensuite que je ne t’avais pas prévenu, mon fils.
Elle s’approcha alors de Sofia, se pencha légèrement vers elle et, d’une voix traînante où perçait un plaisir cruel, murmura :
— Petite poupée de campagne… Tu ferais mieux de te mettre une table dans les toilettes. C’est là que tu mangeras dorénavant. Et tu n’en sortiras pas avant que je te le dise.
Un silence absolu s’abattit sur la cuisine, comme si tout le bruit du monde venait de s’éteindre. Sofia resta figée, incapable de croire ce qu’elle venait d’entendre. Marc se leva si brusquement que sa chaise bascula avec fracas.
— Qu’est-ce que tu viens de dire ? demanda-t-il d’une voix calme, glaciale.
Véra Petrovna se retourna, les sourcils haussés d’un air faussement surpris.
— Allons, Marc, ne t’emporte pas. C’était une simple plaisanterie.
— Une plaisanterie ? répéta-t-il en s’avançant d’un pas. C’était une humiliation, pure et simple. Et ce n’est pas la première fois.
La belle-mère croisa les bras sur sa poitrine avec hauteur, et son visage s’allongea et pâlit.
— Tu veux vraiment m’élever la voix à cause d’elle ?
— À cause d’elle ? À cause de ma femme légitime ? Oui, c’est exactement ça, je m’élève. Parce que j’ai dit stop. Stop à ces piques quotidiennes, à ces insinuations, à ces insultes flagrantes. Tu crois que je ne remarque rien ? Tu crois que je ne vois pas comment tu traites Sofia ?
Lidia Fiodorovna pâlit encore davantage, ses lèvres tremblèrent.
— Mais je suis ta mère. Je t’ai élevé seule, sans aucune aide, je t’ai donné tout ce que j’ai pu…
— Et je t’en suis infiniment reconnaissant. Mais cette maternité ne te donne aucun droit d’humilier quelqu’un que j’aime sincèrement, maman.
Mark se retourna brusquement, s’avança résolument vers Sofia et lui prit fermement la main.
— Rassemble nos affaires. Tout de suite. Nous partons immédiatement d’ici.
— Mark, tu es sérieux ? — La voix de sa mère trembla soudain, et un léger souffle de peur s’y fit entendre. — Où allez-vous ? Vous n’avez rien !
— N’importe où, absolument n’importe où. Mais nous ne resterons pas ici. Pas après tout ça, pas après tes paroles.
Mark entraîna Sofia dans leur chambre. Vera Petrovna resta figée au milieu de la cuisine, les regardant partir, perdue et effrayée.
Dans la chambre, Mark sortit rapidement du placard un grand sac de voyage et commença à y mettre leurs affaires avec détermination. Ses mains bougeaient vite, de manière précise, sans le moindre doute. Sofia resta près de la porte, incapable de prononcer un mot, incapable de bouger. Tout en elle se mélangeait et se renversait : peur, soulagement, méfiance amère — toutes ces émotions formaient un nœud serré et lourd.
— Mark, es-tu sûr de ta décision ? — finit-elle par murmurer, peinant à trouver ses mots.
Son mari s’arrêta un instant et la regarda intensément.
— J’aurais dû le faire bien plus tôt. Pardonne-moi de m’être tu si longtemps, d’avoir fermé les yeux sur tout. Je pensais naïvement que tout s’arrangerait tout seul. Mais rien ne s’est arrangé. Et je ne peux plus rester là, à regarder silencieusement tes souffrances, comment on te humilie devant moi.
Mark ferma le sac, mit sa veste.
— Nous passerons quelques jours chez mon ami Sergey, il nous accueillera, puis nous trouverons rapidement notre propre appartement. Nous y arriverons, je te le promets.
Sofia hocha simplement la tête. Pour la première fois depuis de longs mois difficiles, elle sentit en elle une lueur de véritable espoir. Ce n’était pas encore la joie, pas encore l’euphorie — juste une confiance tranquille et sereine que tout irait bien désormais. À ses côtés se tenait son mari, l’homme le plus proche, celui qui l’avait choisie. Il n’avait pas gardé le silence, il ne s’était pas détourné, il n’avait pas dit le banal « patiente encore un peu ». Il était là, à ses côtés, lui tenant la main.
Mark ouvrit la porte de leur chambre et ils se dirigèrent ensemble dans le couloir. Vera Petrovna était assise à la cuisine, le visage pâle et tendu.
— Mark, attends… ne fais pas ça, — murmura-t-elle presque imperceptiblement. — Restez, s’il te plaît. Je ne me comporterai plus jamais ainsi, je te le promets.
Mark s’arrêta, la porte de l’appartement grande ouverte, et se retourna lentement.
— Maman, les gens ne changent pas en un claquement de doigts. Tu sais juste dire de belles paroles quand cela t’est avantageux. Mais malheureusement, je ne peux plus te croire.
— Mon fils, attends…
— Adieu, maman.
Mark serra la main de Sofia et ils sortirent ensemble sur le palier. La porte se referma derrière eux, doucement, presque sans bruit. Sofia descendit lentement les escaliers, et à chaque marche, le poids invisible qui pesait sur ses épaules depuis des mois s’allégeait peu à peu, jusqu’à disparaître.
Dehors, l’air était frais et venteux, typiquement automnal. Le vent fouettait ses cheveux et la faisait plisser les yeux involontairement. Mark l’entoura de ses bras, la serrant contre lui pour la réchauffer.
— Tout ira bien, je te le promets, — dit-il doucement, mais avec une assurance profonde.
Sofia leva les yeux vers lui et, pour la première fois depuis longtemps, lui offrit un sourire sincère et véritable.
Ils passèrent la nuit chez Sergey, un vieil ami de Mark, dans son petit appartement à la périphérie de la ville. L’hôte leur avait préparé un canapé, du thé chaud et s’était retiré dans sa chambre avec discrétion, sans poser de questions inutiles. Sofia resta dans le noir, écoutant la respiration calme de son mari et incapable de fermer l’œil. Ses pensées tourbillonnaient : que se passerait-il ensuite, où vivraient-ils, l’argent suffirait-il pour cette nouvelle vie ? Mais curieusement, la peur avait disparu. Il ne restait qu’une certitude solide que, pour la première fois depuis des mois, leur vie suivait enfin le cours qu’elle aurait dû prendre depuis le début.
Le matin, Mark se leva le premier, s’habilla discrètement et sortit, revenant seulement deux heures plus tard avec une pile d’annonces de locations et son téléphone à la main.
— J’ai trouvé quelques options convenables, — dit-il en s’asseyant sur le bord du canapé. — Nous irons visiter aujourd’hui.
Sofia hocha la tête, enfilant son pull chaud.
— Et l’argent ? Pour la caution et le loyer, ce n’est pas une somme négligeable.
— J’ai mis de côté un peu d’argent. Ça suffira pour le premier mois et le dépôt. Pour la suite, on s’arrangera, ne t’inquiète pas.
Mark parlait calmement, comme s’il gérait une tâche ordinaire. Sofia voyait en lui un homme concentré sur l’action concrète, ce qui la rassurait et lui donnait de la force.
Vers midi, ils avaient déjà visité trois appartements différents. Le premier était trop cher, le second dans un état lamentable, mais le troisième leur convenait parfaitement. Un petit appartement d’une pièce au deuxième étage d’un vieil immeuble, avec une rénovation cosmétique datant de cinq ans. Le mobilier était simple, mais fonctionnel et intact. Les fenêtres donnaient sur une cour tranquille avec de grands peupliers et des balançoires pour enfants. La propriétaire, Irina, une femme agréable d’âge moyen, posa quelques questions polies sur leur travail et demanda seulement un mois de loyer d’avance.
Mark sortit l’argent, compta soigneusement et la remit à la propriétaire. Irina rédigea un reçu, remit les clés et leur souhaita sincèrement bonne chance.
Lorsque la porte se referma derrière elle, Sofia parcourut lentement la pièce, comme dans un rêve, et s’arrêta près de la grande fenêtre. La vue était ordinaire : asphalte gris, arbres nus, immeubles voisins. Mais c’était leur vue. Leur espace, indépendant et à eux seuls.
— Tout va bien ? Ça te convient ? — demanda Mark en s’approchant d’elle par derrière et en la prenant dans ses bras.
— Parfait, — répondit Sofia doucement, avec assurance. — Très bien même.
Mark la serra encore plus fort. Ils restèrent ainsi quelques minutes, simplement à contempler la vie qui s’offrait désormais à eux.
Le lendemain commença leur déménagement. Mark emprunta la voiture de Sergey et ils allèrent récupérer leurs affaires chez sa mère. Sofia appréhendait cette rencontre inévitable, mais se prépara à rester calme et digne. Mark l’avait prévenue : pas de longues discussions émotionnelles, juste récupérer leurs affaires et partir.
Vera Petrovna leur ouvrit la porte, le visage tendu, impassible.
— Mark, — commença-t-elle, mais il leva poliment mais fermement la main pour la faire taire.
— Nous sommes venus uniquement chercher nos affaires. Et nous n’avons besoin de rien de plus de ta part, maman.
Elle se retira, laissant passer les deux jeunes. Ils rassemblèrent leurs affaires en silence, sans un regard ni un mot. Lorsqu’ils eurent terminé, Mark prit la dernière boîte et sortit. Sofia fit un dernier pas dans la chambre, jetant un dernier regard à cet endroit où elle avait passé trois mois des plus difficiles de sa vie.
Mark porta toutes les boîtes jusqu’à la voiture et revint chercher le dernier sac. Vera Petrovna fit un pas incertain et sa voix trembla :
— Mark, pourquoi tant de dureté ? On pourrait parler, tout arranger…
Mark la regarda longuement, fatigué.
— Maman, je ne veux pas me disputer. Mais nous avons besoin de vivre seuls un temps. Peut-être qu’un jour tout ira mieux, mais pas maintenant.
— Et tout cela à cause d’elle ? — demanda Vera, désignant Sofia.
— Non, maman, c’est à cause de nous. Parce que je veux vivre avec ma femme aimée, dans une atmosphère calme et normale, sans cette tension permanente.
Ils sortirent, et cette fois la porte de leur ancienne vie se referma derrière eux doucement, presque sans bruit. Dans leur nouvelle maison, ils déchargèrent les affaires en silence. Les boîtes alignées, les sacs posés sur le sol, Mark observant parfois par la fenêtre, Sofia comprenant parfaitement que certaines choses importantes n’ont pas besoin de paroles.
Le soir venu, la majorité des affaires étaient déballées, la vaisselle à sa place, les vêtements dans l’armoire. Sofia sortit sa tasse en céramique préférée, un cadeau de sa grand-mère, et la posa fièrement sur la table. Mark accrocha leur photo commune au mur, un souvenir de vacances heureuses au bord d’une rivière.
Ils dînèrent tranquillement, préparant le repas et le thé, accomplissant les gestes simples de la vie quotidienne, mais désormais empreints d’une intimité nouvelle et précieuse.
— Pardonne-moi, — murmura Mark soudain, mettant sa fourchette de côté.
Sofia leva les yeux, étonnée.
— Pour quoi ?
— D’avoir gardé le silence si longtemps. De ne pas t’avoir protégée plus tôt de ma mère. J’ai naïvement cru que tout s’arrangerait.
Il prit ses mains, les serrant, transmettant sa chaleur.
— Je n’aurais jamais dû te laisser subir ça, chérie. Tu ne méritais rien de tout cela.
Sofia sentit les larmes monter, mais cette fois, c’était un soulagement lumineux et émouvant.
— L’important, mon cher, c’est que tu l’aies fait maintenant, quand il le fallait vraiment, — répondit-elle doucement, avec assurance.
Mark acquiesça en silence, tenant toujours ses mains.
Les premiers jours dans leur appartement se déroulèrent calmement. Mark partait tôt le matin et revenait le soir. Sofia travaillait au supermarché selon un planning variable. Mais chaque fois qu’elle insérait sa clé dans la serrure, elle ressentait un bonheur vif et pur : elle rentrait chez elle, là où on l’attendait et où on l’appréciait.
Vera Petrovna continua d’appeler au début, mais ses efforts pour influencer leur vie échouèrent. Mark répondait poliment mais fermement, sans offrir de terrain pour de nouvelles discussions. Les rumeurs sur leur départ cessaient peu à peu de toucher Sofia.
Un soir, alors qu’elle faisait la vaisselle, sa tante Valentina appela, souhaitant persuader Sofia de revenir. Sofia resta calme, expliquant poliment mais fermement qu’ils avaient pris la bonne décision pour leur famille. Mark, l’ayant entendu, proposa de répondre lui-même, mais Sofia l’arrêta : elle gérait parfaitement la situation.
Une semaine plus tard, les appels cessèrent complètement. Leur vie prit un rythme paisible et mesuré. Sofia sentit sa voix changer, devenir plus assurée. Au travail, elle fut félicitée et invitée plus souvent à déjeuner avec ses collègues. À la maison, aucune tension ne venait troubler leur quotidien. Les tâches ménagères se répartirent naturellement, harmonieusement.
Un samedi matin, Sofia se réveilla avec l’odeur du pain grillé. Mark avait préparé le petit déjeuner, tea et toasts fumants.
— Bonjour, ma belle. Bien dormi ?
— Oui, — répondit-elle en s’étirant et bâillant.
— Tu t’es levée tôt pour un jour de repos ?
— Je ne pouvais pas dormir, j’ai pensé à nous. Alors j’ai préparé un bon petit-déjeuner.
Ils prirent le thé et discutèrent doucement. Mark la remercia pour sa fidélité et sa confiance.
— Je ne pourrais jamais agir autrement, — dit Sofia avec tendresse. — Je t’aime, Mark, plus que tout.
Mark prit sa main, l’embrassa et scella cette promesse silencieuse.
Un mois plus tard, leur nouvelle vie s’était installée. Les soirées se passaient dans la tranquillité : dîners, discussions, films, musique. Un soir, en écoutant Sofia chanter doucement dans la cuisine, Mark comprit que leur décision avait été la bonne.
Ils s’installèrent avec leur thé sur le canapé, profitant de la simplicité et de la plénitude de leur vie.
— Tu as réfléchi à quelque chose ? — demanda Sofia.
— Non, à rien de particulier. Je pensais juste à notre chance.
— Chance ?
— Oui, nous aurions pu continuer à subir avec ma mère, mais nous avons eu la force de partir. Et maintenant, notre vie est bien meilleure, plus calme et plus heureuse.
Sofia se blottit contre lui, fermant les yeux, savourant la plénitude de l’instant.
Ils restèrent là longtemps, buvant leur thé, écoutant les sons apaisants de la ville. La vie coulait doucement, comme une rivière tranquille, emportant avec elle toutes les inquiétudes et tristesses. Et dans cette simplicité, ils avaient trouvé un vrai bonheur, qui ne demandait aucune preuve, aucun mot grandiloquent. Il était simplement là, toujours, à leurs côtés.