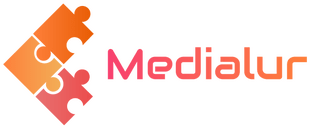Lorsque la soutenance prit fin, le professeur Santos s’avança pour serrer la main à ma famille et à moi. Mais lorsqu’il arriva devant Tatay Ben, il s’arrêta net, le dévisagea longuement, et son expression changea.
Je suis né dans une famille incomplète. À peine savais-je marcher que mes parents divorçaient. Ma mère, Nanay Lorna, me ramena alors à Nueva Ecija, cette campagne pauvre où il n’y avait que des rizières, du soleil, du vent et des commérages. Je ne me souviens presque pas du visage de mon père biologique ; je sais seulement que mes premières années manquaient tout autant d’affection que de moyens.
Quand j’avais quatre ans, ma mère se remaria. L’homme qu’elle épousa était ouvrier du bâtiment. Il n’apporta avec lui ni maison, ni argent—rien d’autre qu’un dos maigre, une peau tannée par le soleil et des mains durcies par le ciment.
Au début, je ne l’aimais pas. Il m’était étranger, partait avant l’aube, rentrait tard le soir, toujours imprégné de sueur et de poussière de chantier. Pourtant, c’est lui qui répara ma vieille bicyclette, qui raccommoda mes sandales sans un mot. Quand je faisais des bêtises, il ne me grondait pas : il nettoyait simplement derrière moi. Le jour où l’on me persécuta à l’école, il ne me sermonna pas comme ma mère ; il enfourcha simplement sa vieille bicyclette pour venir me chercher. Sur le chemin du retour, il se contenta de dire :
— « Tatay ne t’oblige pas à m’appeler papa, mais si tu as besoin de moi, je serai toujours derrière toi. »
Je n’ai rien répondu. Mais, à partir de ce jour, j’ai commencé à l’appeler Tatay.
Tout au long de mon enfance, mes souvenirs de Tatay Ben furent ceux d’une vieille bicyclette, d’un uniforme de chantier encore couvert de poussière, et de ces nuits où il rentrait tard, les yeux cernés, les mains encore blanches de chaux et de mortier. Quelle que soit l’heure, il ne manquait jamais de demander :
— « Comment s’est passée l’école aujourd’hui ? »
Il n’avait pas beaucoup d’instruction, ne pouvait pas m’expliquer des équations complexes ni des textes difficiles, mais il répétait toujours :
— « Tu n’as pas besoin d’être le meilleur, mais tu dois étudier sérieusement. Où que tu ailles, on te respectera pour ton savoir. »
Ma mère était paysanne, Tatay était ouvrier du bâtiment. Nous vivions de peu. J’étais bon élève, mais je connaissais notre situation ; je n’osais pas rêver trop loin. Le jour où je réussis l’examen d’entrée à l’université de Manille, ma mère éclata en sanglots ; Tatay, lui, resta assis sur la véranda, tirant sur une cigarette bon marché. Le lendemain, il vendit sa seule moto et ajouta aux économies de ma mère de quoi m’envoyer étudier.
Lorsqu’il m’accompagna en ville, Tatay portait une vieille casquette de baseball, une chemise froissée ; son dos était trempé de sueur. Il tenait une boîte remplie de « cadeaux du pays » : quelques kilos de riz, un bocal de tuyo ou de tinapa, et quelques sachets de cacahuètes grillées. Au moment de me laisser au dortoir, il me dit simplement :
— « Donne tout ce que tu peux, fils. Étudie bien. »
Je ne pleurai pas. Mais en ouvrant le repas que ma mère avait enveloppé dans des feuilles de bananier, je trouvai, glissé en dessous, un petit papier plié en quatre, griffonné à la hâte :

— « Tatay ne sait pas ce que tu étudies, mais quoi que ce soit, Tatay te soutiendra. Ne t’inquiète pas. »
Pendant mes quatre années de licence, puis en master, Tatay continua de travailler. Ses mains devinrent de plus en plus rugueuses, son dos de plus en plus courbé. Lorsque je rentrais à la maison, je le voyais, assis au pied de l’échafaudage, haletant après une journée passée à grimper et à porter des charges. Mon cœur se serrait. Je lui disais de se reposer, mais il balayait ma remarque d’un geste :
— « Ce n’est rien. »
— « Tatay en est encore capable. Quand je me sens fatigué, je me dis : je suis en train d’élever un futur docteur — et j’en suis fier. »
J’ai souri sans oser lui dire qu’un doctorat exige bien plus encore, une charge de travail plus lourde, une persévérance plus dure à tenir. Mais c’est pour lui que je ne me suis jamais permis d’abandonner.
Le jour de la soutenance de ma thèse, à l’Université des Philippines à Diliman, il m’a fallu supplier Tatay longuement avant qu’il accepte de venir. Il avait emprunté un costume à son cousin, enfilé des chaussures trop petites d’une taille, et mis le chapeau neuf qu’il venait d’acheter au marché du district. Il s’est assis tout au fond de l’auditorium, le dos bien droit, les yeux fixés sur moi sans jamais vaciller.
Après la soutenance, le professeur Santos a serré la main à ma famille. Lorsqu’il s’est arrêté devant Tatay, il s’est soudain figé, l’a observé attentivement, puis a souri :
— « Vous êtes Mang Ben, n’est-ce pas ? Quand j’étais enfant, ma maison se trouvait près d’un chantier où vous travailliez à Quezon City. Je me souviens du jour où vous avez porté un ouvrier blessé jusqu’en bas de l’échafaudage, alors que vous étiez vous-même blessé. »
Avant même que Tatay ne puisse répondre, le professeur, déjà ému, a ajouté :
— « Je ne m’attendais pas à vous revoir aujourd’hui… en père d’un nouveau docteur. C’est un véritable honneur. »
Je me suis retourné : Tatay Ben souriait. Un sourire discret, mais les yeux rougis. À cet instant, j’ai compris : jamais, de toute sa vie, il ne m’avait demandé de lui rendre quoi que ce soit. Ce jour-là, c’était lui qu’on reconnaissait — non pas pour moi, mais pour tout ce qu’il avait semé, en silence, depuis vingt-cinq ans.
Aujourd’hui, je suis maître de conférences à Manille. J’ai ma propre petite famille. Tatay ne construit plus : il cultive des légumes, élève quelques poules, lit son journal le matin et fait du vélo dans le barangay l’après-midi. Parfois, il m’appelle pour me montrer fièrement ses plates-bandes derrière la maison, ou pour me dire de passer chercher des poulets et des œufs pour son petit-fils. Je lui demande :
— « Tatay ne regrette-t-il pas d’avoir travaillé si dur toute sa vie pour son fils ? »
Il rit :
— « Aucun regret. J’ai travaillé toute ma vie… mais ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir construit un fils comme toi. »
Je ne réponds rien. Je regarde seulement ses mains à l’écran — ces mains qui ont porté tout mon avenir.
Je suis docteur. Tatay Ben est ouvrier du bâtiment. Il ne m’a pas construit une maison : il a “construit” un être humain.