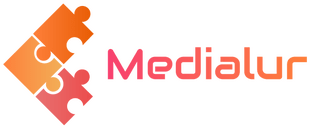À peine Anna avait-elle franchi le seuil de son lieu de travail qu’une ambulance s’arrêta devant le bâtiment peint d’un gris modeste. Derrière elle, arriva une file de voitures richement décorées de rubans et de fleurs. Le contraste était si étrange, si contraire à toute logique, que ses collègues, pris de curiosité, sortirent un à un pour voir ce spectacle insolite de leurs propres yeux. Un cortège nuptial devant un institut médico-légal : cela ne se voit qu’une fois dans une vie — si tant est que cela se voie jamais.
Le changement d’équipe tombait à ce moment précis ; aussi, une petite foule se forma, chuchotant, fascinée par cette scène incongrue. Anna, elle, préféra s’écarter et se réfugier à l’ombre d’un vieux érable. Elle travaillait ici depuis peu — quelques mois à peine — et connaissait à peine ses collègues. De toute manière, elle n’avait guère cherché à tisser des liens. Elle sentait leurs regards silencieux, pleins d’interrogations et de non-dits. Tous savaient d’où elle venait, sans jamais l’avoir formulé à voix haute.
Anna sortait tout juste de prison. Personne ne lui avait demandé ce qu’elle avait fait, mais le poids de cette connaissance muette planait dans l’air, lourd et invisible.
Elle se contentait d’accomplir son travail : laver les sols, vider les poubelles, maintenir la propreté des lieux. Certains pensaient sans doute qu’il valait mieux cela qu’un retour vers les ténèbres. Mais son crime n’avait rien à voir avec l’argent. Des années auparavant, Anna avait ôté la vie à son mari. Leur union n’avait duré qu’un an, mais il n’avait suffi que de quelques jours pour comprendre : derrière le charme séduisant se cachait un véritable monstre, un homme qui jouait parfaitement son rôle jusqu’à ce que le masque tombe.
Année après année, il avait brisé sa volonté. Orpheline, élevée dans un foyer d’État, Anna n’avait personne vers qui se tourner. Un soir, alors qu’il levait encore la main sur elle, ses doigts s’étaient refermés d’eux-mêmes sur le manche froid d’un couteau de cuisine.
Sa belle-famille, nombreuse et influente, réclama la peine la plus sévère. Mais la juge, une femme aux cheveux d’argent et au regard fatigué, déclara qu’il existe des actes que l’on ne punit pas — que parfois, il faudrait presque remercier, car ils débarrassent le monde de sa souillure. Anna écopa de sept ans, mais fut libérée au bout de six pour bonne conduite.
Les portes des emplois ordinaires restaient closes. Jusqu’au jour où, passant devant ce bâtiment gris, elle remarqua une petite affiche : *« Recherche femme de ménage »*. Le salaire indiqué était étonnamment élevé. Elle se présenta, prête à un refus poli, et raconta toute son histoire sans rien cacher. À sa grande surprise, on l’embaucha.
Les premières semaines furent terribles ; chaque minute dans ces murs lui coûtait un effort. Un vieux préparateur, Semionovitch, remarqua sa pâleur et ses mains tremblantes. Il lui dit un jour, d’une voix calme :
— Ce sont les vivants qu’il faut craindre, ma chère. Ceux-là… ne peuvent plus faire de mal à personne.
Ces mots restèrent en elle, comme une ancre. Peu à peu, Anna apprit à travailler sans frissonner, sans craindre le silence, ni l’écho de ses pas.
—
Ce jour-là, les brancardiers sortirent de l’ambulance une civière. Dessus reposait une jeune femme en robe de mariée, couverte de perles fines. À côté, un homme, le visage défait, suivait chaque geste sans les voir vraiment. Son regard demeurait rivé au visage immobile de celle qu’il aimait. Il fallut plusieurs proches pour l’éloigner, tant il voulait rester auprès d’elle.
En passant, Anna surprit des bribes de conversation : la mariée avait été empoisonnée — par sa propre amie, pendant la fête. Autrefois, cette amie avait été aimée du même homme. Ne pouvant supporter la perte, elle avait glissé le poison dans la coupe de la nouvelle élue.
Quand Anna passa près du corps, elle s’arrêta. La jeune femme semblait paisible, presque vivante. *« Trop belle pour la mort »*, pensa-t-elle.

— Anna, finis ce box et repasse ici avant de fermer, lui lança Semionovitch.
— Vous ne ferez pas l’examen ce soir ? demanda-t-elle doucement.
— Non, j’ai une affaire urgente, répondit-il. Demain matin, je reprendrai. Ces gens-là… ont tout le temps du monde. Ils peuvent attendre.
Ses pas s’éloignèrent, et Anna resta un moment songeuse : peut-être ce métier, plus que tout autre, apprend-il à regarder la vie autrement.
—
Plus tard, en rangeant, elle revint dans la salle où reposait la mariée. Son teint paraissait étrangement frais. *« Sans doute l’effet du poison »*, pensa-t-elle. En réarrangeant la main du corps, elle sursauta : la peau était tiède, souple. Le cœur battant, elle chercha un miroir, le posa devant la bouche de la jeune femme… et vit la buée se former.
— Mon Dieu… murmura-t-elle.
Elle se précipita dans le couloir, croisant un jeune infirmier, Artom.
— Vite, viens ! Je crois… je crois qu’elle vit !
En un instant, le calme du service vola en éclats. Artom posa son stéthoscope, pâlit, puis s’exclama :
— Elle respire ! Le cœur bat encore !
Anna, tremblante, courut dehors prévenir le marié, qui était resté assis, hagard, sur un banc.
— Votre femme… elle est vivante !
Il releva la tête, incrédule. Mais déjà, une autre ambulance arrivait en trombe.
— Vous ne mentez pas ?
— Non. Elle respire, je vous jure.
Il bondit et courut vers la porte, juste au moment où les médecins sortaient la civière.
— Je suis son mari ! Laissez-moi rester avec elle !
— Montez, vite. Chaque seconde compte, dit le docteur.
L’ambulance s’éloigna dans un cri de sirène. Anna et Artom restèrent immobiles, sidérés.
— Tu as accompli un miracle, murmura-t-il enfin. Si le froid de la salle n’avait pas ralenti les effets du poison, elle ne serait plus là. Le produit imitait la mort à la perfection.
Anna essuya une larme et répondit doucement :
— Une vie pour une autre. J’en ai pris une autrefois… peut-être ai-je rendu celle-ci.
Artom sourit.
— Viens, allons boire un thé. Pas très romantique comme lieu, mais je crois qu’on l’a bien mérité.
Ils sortirent s’asseoir sur le banc. Sous le ciel du soir, les mots vinrent d’eux-mêmes. Il lui parla de sa vie, de la guerre, du jour où il avait décidé de devenir médecin. Puis, d’une voix douce :
— Et vous, Anna… que s’est-il passé ?
Elle raconta tout. Longuement. Sans défense, sans détour. Quand elle se tut, il dit simplement :
— Vous n’avez rien à vous reprocher. Rien.
C’était la première fois que quelqu’un lui disait cela.
—
Quelques jours plus tard, Anna vit la jeune mariée et son époux revenir au service. Ils semblaient rayonner de bonheur. La jeune femme, encore pâle mais vivante, s’approcha et lui tendit un bouquet de roses blanches.
— Vous nous avez rendus à la vie. Vous n’avez pas le droit de refuser notre invitation. Il faut que vous soyez heureux, vous aussi.
Mais Anna et Artom refusèrent toute fête. La mariée insista, leur offrant un cadeau inespéré : un voyage au bord de la mer. Anna n’avait jamais vu l’océan.
Ils se marièrent discrètement. Anna quitta son travail ; Artom lui promit qu’il veillerait à ce qu’elle découvre la beauté du monde.
Sur la plage, face à l’immensité bleue, Anna sentit le vent salé lui caresser le visage. Le grondement des vagues battait comme un grand cœur apaisé. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, sa propre âme déploya ses ailes. Le passé s’effaçait comme une ombre, et l’avenir l’accueillait avec la clarté du soleil levant.
Dans ce moment parfait, il n’y avait ni hier, ni demain — seulement le présent, vaste, doux, et infiniment clément.