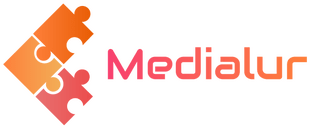J’avais poussé ma femme dans le petit débarras qui servait de cagibi, simplement parce qu’elle avait osé contredire ma mère. Mais au matin, quand j’ai tourné la poignée… elle avait disparu. Et à cet instant précis, j’ai compris que j’avais franchi une ligne irréversible.
J’étais persuadé qu’elle n’oserait jamais partir. Sa famille vivait à Lyon, à plus de 500 kilomètres. À Nantes, où nous habitions, elle ne connaissait personne d’autre que moi. Elle n’avait même pas accès à tous les comptes du foyer. Avec cette certitude, j’ai dormi comme un roi, tandis que ma mère, installée dans la chambre d’amis juste à côté, ronflait paisiblement.
Ma mère, Madame Colette, s’est toujours perçue comme une femme sacrifiée, une matriarche ayant tout donné. Elle voulait que ma femme lui obéisse en toutes choses. Je pensais :
« En tant que fils, je dois m’occuper de mes parents. Une épouse doit juste supporter un peu… où est le mal ? »
Marianne venait d’une autre région. Nous nous étions rencontrés pendant nos études à Nantes. Quand nous avons parlé mariage, ma mère s’y est opposée dès le début :
— « La famille de cette fille habite trop loin. Cela va coûter une fortune à chaque visite. »
Marianne avait pleuré, mais elle avait répondu calmement :
— « Ne vous inquiétez pas. Je serai votre belle-fille et je prendrai soin de votre famille. Je n’irai chez mes parents qu’une fois par an, si nécessaire. »
Finalement, j’ai supplié, et ma mère a fini par accepter à contrecœur. Mais à partir de là, chaque fois que je voulais emmener Marianne et notre fils voir mes beaux-parents, ma mère inventait une excuse.
À la naissance de notre premier enfant, les tensions se sont accentuées. Nous avions des désaccords sur son éducation. Je pensais : « Ma mère veut juste le meilleur pour son petit-fils, ce n’est pas mal de lui faire confiance. » Mais Marianne résistait. Les disputes devenaient incessantes, même pour des détails anodins comme la purée ou le lait. Ma mère s’énervait, claquait des assiettes, et prétextait tomber malade de colère.

Lors d’une récente visite chez ma mère à Rennes, tout a dégénéré. Le bébé a eu une forte fièvre et des convulsions. Ma mère a accusé Marianne :
— « Tu ne sais même pas t’occuper de mon petit-fils ! Comment as-tu pu le laisser tomber malade ainsi ? »
Aveuglé par la colère, je l’ai crue. Ma frustration s’est alors retournée contre Marianne. Elle, épuisée, ne cachait plus sa fatigue.
Cette nuit-là, elle n’a pas fermé l’œil, veillant sur notre fils. Moi, harassé par le voyage, je suis allé dormir dans la chambre de mes parents.
Le lendemain, des cousins sont arrivés. Ma mère a tendu vingt euros à Marianne pour aller faire les courses. J’ai vu son épuisement, mais je n’ai pas eu le temps de réagir que ma mère a crié :
— « Si j’y vais moi-même, les gens se moqueront de toi ! Elle n’a qu’à s’en occuper, c’est la belle-fille ! »
À bout de forces, Marianne a répondu :
— « J’ai veillé votre petit-fils toute la nuit. Vos invités sont les vôtres, pas les miens. Je suis votre belle-fille, pas votre bonne. »
Ma mère m’a lancé un regard noir. Submergé par la honte devant la famille, aveuglé par ma colère, j’ai saisi Marianne par le bras et l’ai enfermée dans le débarras, sans matelas, sans couverture. Je lui ai dit :
— « Je dois être dur pour que tu apprennes à respecter ma mère. »
Le lendemain, quand j’ai ouvert la porte… elle avait disparu.
La panique m’a envahi. Ma mère a appelé toute la famille pour la chercher. Une voisine nous a raconté :
— « Je l’ai vue hier soir, en larmes, avec une valise. Je lui ai donné de l’argent pour un taxi jusqu’à l’aéroport. Elle a dit que vous la traitiez comme une domestique… et qu’elle demanderait le divorce. »
J’ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Peu après, Marianne a décroché. Sa voix était glaciale :
— « Je suis chez mes parents. Dans quelques jours, je déposerai la demande de divorce. Notre fils restera avec moi. Et la moitié de nos biens m’appartient, c’est la loi. »
Ma mère hurla :
— « Elle bluffe ! Elle ne fera jamais ça ! »
Mais moi, je savais : Marianne n’était plus la même.
Trois jours plus tard, une enveloppe marron est arrivée. À l’intérieur : les papiers du tribunal de Lyon. Motif : violence psychologique de la part de mon mari et de sa famille.
Ma mère est devenue rouge de rage :
— « Une femme divorcée, c’est la honte de la famille ! Laisse-la, elle reviendra en rampant ! »
Mais je ne ressentais plus de colère. Seulement la peur.
Si nous divorçions, je perdrais la garde de mon fils. La loi favorise la mère pour les enfants en bas âge.
Les cousins bretons me répétaient :
— « Léo, t’as été stupide. »
— « Enfermer ta femme ? Mais t’es fou ! »
— « Toute la ville est au courant. Qui voudra encore de toi ? »
J’étais noyé dans la honte.
Ce soir-là, j’ai appelé Marianne. Elle est apparue à l’écran, notre fils endormi sur sa poitrine. Mon cœur s’est brisé.
— « Marianne… laisse-moi le voir. Il me manque. »
Elle m’a fixé droit dans les yeux :
— « Maintenant tu te souviens de ton fils ? Et de moi, quand tu m’as enfermée comme un déchet, tu t’en souvenais ? C’est trop tard, Léo. Je ne reviens pas. »
Les jours suivants n’étaient qu’un long tunnel. Je rêvais qu’elle s’éloignait avec notre enfant et que je n’arrivais pas à les atteindre.
J’ai compris qu’en deux ans, je n’avais écouté que ma mère. Jamais ma femme. Je ne l’avais pas protégée. Je l’avais trahie.
Un matin, ma tante Suzanne est venue me voir :
— « Écoute, mon garçon. Quand une femme dépose une demande, elle ne revient presque jamais en arrière. Tu n’as que deux choix : accepter… ou t’excuser sincèrement. Et dépêche-toi. Toute la famille est déjà au courant. »
J’ai respiré profondément. Ma mère, la pression, les regards… tout pesait sur moi.
Mais ma plus grande peur était simple : ne plus jamais entendre mon fils m’appeler « papa ».
Ce soir-là, sous le ciel breton, j’ai compris qu’il était temps de faire ce que je n’avais jamais eu le courage de faire : me dresser contre ma mère et me battre pour récupérer ma femme et mon enfant.