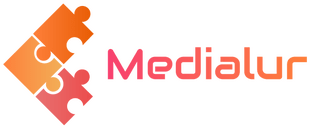Un faible rayon de soleil couchant, filtrant à travers la vitre sale de la cuisine, peinait à illuminer deux silhouettes immobiles, figées dans une attente muette. L’air était lourd, saturé d’odeurs mêlées de soupe aux choux, de tabac bon marché et d’une autre senteur, plus âcre, plus tenace : celle de la peur. Elle imprégnait tout — les murs, le linoléum craquelé, jusqu’aux pores mêmes de cette cage décrépite.
Anna et sa fille de sept ans, Katya, demeuraient assises, retenant leur souffle, craignant que le moindre cliquetis de cuillère dans leurs bols vides ne déclenche la tempête. Chaque craquement du plancher, chaque soupir discret prenait la démesure d’un tonnerre. Leur monde s’était réduit à cette cuisine étroite, dont le centre de gravité — un gouffre obscur — était la porte close de la chambre. Derrière ce contreplaqué mince dormait leur mari, leur père. Et Anna priait pour qu’il ne se réveille pas. Elle priait pour que son sommeil précaire maintienne encore, pour quelques heures, l’équilibre fragile de leur univers.
Mais l’univers, lui, reste sourd aux prières des créatures traquées. Un bruit lourd, écœurant, retentit soudain : un corps s’abattant hors du lit. Puis des grognements, des jurons rauques, des pas mal assurés en direction de la salle de bain. Le cœur d’Anna se contracta. Katya se blottit contre elle, les yeux écarquillés par la terreur.
La porte de la cuisine s’ouvrit brusquement, laissant s’engouffrer une vague d’alcool et de colère. Il apparut sur le seuil, massif, titubant, les yeux rougis par les vapeurs et les nuits sans sommeil. Son regard trouble glissa sur elles comme sur des ombres.
— Mange, dit-il d’une voix rauque, la syllabe résonnant comme une sentence.
Katya bondit, se glissant hors de portée, et disparut dans sa cachette habituelle : l’étroit espace entre le canapé et le mur. De là, sa voix minuscule, étranglée, parvint à peine jusqu’à eux.
— Anka… donne-moi l’argent ! Vite !
La voix d’Anna se fit tremblante, presque un souffle.
— Sergueï… Il ne nous reste que deux cents roubles. Encore une semaine avant la paie… C’est pour le pain…
— T’es folle ou quoi ?!
Il s’approcha d’elle, et soudain, la pièce sembla rapetisser. Ses doigts épais se refermèrent sur son épaule, enfonçant la chair. Elle cria.
— Où est le portefeuille, salope ? Dis-le-moi !
Aveuglée par la peur, elle balbutia :
— Sur… sur le rebord de la fenêtre. Là.
Il la repoussa d’un geste brutal. Elle heurta le bord du placard, haletante, les larmes aux yeux. Sergueï saisit le portefeuille élimé, en sortit quelques billets froissés et les jeta à terre.
— Merde.
Une minute plus tard, la porte d’entrée claqua avec une telle violence que la vitre du buffet trembla.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Il résonnait dans les tempes d’Anna comme une douleur sourde. Quelques instants plus tard, le visage pâle de Katya apparut dans l’embrasure de la porte.
— Maman… Papa est parti ?
Anna resta un moment muette, puis un mince filet de voix s’échappa.
— Parti, mon poisson. Assieds-toi. Finis ta soupe.
Elle lui versa un nouveau bol de bouillon clair, où flottaient quelques pommes de terre et des miettes de poisson en conserve. Katya se mit à manger avec une avidité silencieuse : à sept ans, on a toujours faim, mais la nourriture, dans cette maison, était une invitée rare.

Demain serait dimanche : deux jours sans école. Et elle aimait tant l’école… Là-bas, ça sentait le porridge et la peinture à l’eau. Il y avait des jouets, des maîtresses qui souriaient, et surtout, l’absence de peur. Pas de cris, pas de poings lourds. Ici, à la maison, il fallait se faire petite, se taire, respirer sans bruit.
Anna s’allongea près de sa fille, la serra contre elle. L’enfant s’endormit vite, épuisée. Anna, elle, resta les yeux ouverts, guettant chaque craquement. Son corps entier était tendu comme une corde. Elle connaissait la suite du scénario : il reviendrait au cœur de la nuit, titubant, furieux, cherchant querelle. Katya pleurerait, se cacherait. Et elle… elle servirait encore de bouclier.
Mais la fatigue finit par l’emporter. Un demi-sommeil l’enveloppa, lourd, peuplé de cauchemars indistincts.
—
Un rayon de soleil la réveilla. Chaud, insolent, tombant droit sur son visage. Son cœur bondit. Silence. Un vrai silence, pas celui, tendu, des matins d’attente. Elle fit le tour de l’appartement sur la pointe des pieds. Vide. Il était parti.
Peut-être chez sa mère, pensa-t-elle. Ou chez cet « ami » de beuverie. L’idée d’un jour sans lui lui parut presque indécente. Un luxe.
— Katioucha, debout ma chérie, murmura-t-elle avec une douceur oubliée.
Elles prirent leur petit-déjeuner en paix. Même le silence semblait nouveau, léger.
— Prépare-toi, ma fille. On va faire des courses.
Elle décrocha la vieille boîte à thé cachée derrière la vaisselle. Mille roubles, soigneusement pliés : son trésor pour les mauvais jours. Elle sourit tristement. *Il n’y a que des jours pluvieux ici, mais celui-ci ressemble à une éclaircie.*
Elles achetèrent du pain, du lait, des pâtes, un peu de viande… et une glace pour Katya. La fillette léchait son cornet avec extase, tandis qu’Anna portait les sacs, le cœur battant de peur à chaque coin de rue : *et s’il était là ? s’il revenait ?*
Mais l’appartement demeura vide.
Elles déjeunèrent de pâtes fumantes. Anna contemplait le visage paisible de sa fille.
*Les enfants ont besoin de si peu pour être heureux,* pensa-t-elle. *Un peu de silence, un morceau de pain sans peur.*
La journée s’étira dans une quiétude irréelle. Pour la première fois depuis des années, aucun cri ne déchirait l’air.
Le soir venu, le téléphone sonna. Sur l’écran : « Belle-mère ». Anna sentit la sueur lui couler dans le dos. Elle décrocha.
— S… !
Ce n’était pas une voix, mais un hurlement animal, déchirant.
— C’est toi ! Toi, maudite ! C’est toi ma douleur !
Puis un bruit de chute, des cris étouffés, et la ligne se coupa.
Katya, les yeux grands, demanda :
— Maman, c’était qui ?
— Ta grand-mère.
— Pourquoi elle crie comme ça ?
— Je… je ne sais pas, ma chérie.
Le téléphone retentit de nouveau. Cette fois, c’était son beau-père. Sa voix, métallique, semblait venir d’un autre monde.
— Anna… Sergueï est mort.
Le monde chancela.
— Quoi ?
— Une rixe d’ivrognes. Un couteau.
— Où… où est-il ? cria-t-elle sans comprendre pourquoi elle criait.
— Tu n’as pas besoin de venir. Je m’occupe de tout. L’enterrement aura lieu mardi.
Il raccrocha. Anna s’assit lentement, vidée.
— Maman ? Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Katya.
— Papa… Papa est mort, ma chérie.
Les larmes jaillirent — non pas de chagrin, mais de soulagement. Un soulagement si profond qu’il en devenait douloureux. Des larmes de délivrance.
— Maman, ça veut dire quoi, “mort” ? Il ne reviendra plus jamais ?
— Non, mon petit poisson. Plus jamais.
À cet instant précis, l’interphone retentit — strident, familier. Le réflexe fut immédiat : elles sursautèrent, s’agrippant l’une à l’autre. Anna décrocha, tremblante.
— Oui ?
— Police. Lieutenant Orlov. Êtes-vous bien Anna Zakharovna ?
— Oui…
— J’aurais quelques questions à vous poser au sujet de votre mari, Sergueï Viktorovitch Kovalev. Puis-je monter ?
Elle eut envie de dire *non*. De barrer la porte au passé. Mais elle soupira :
— Montez.
Le policier était jeune, le regard fatigué. À la table de la cuisine, il sortit son carnet.
— Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois ?
— Hier soir. Il est parti vers six heures.
— Ivre ?
— Pas encore. En colère.
— Il vous a frappée ?
Il observa les ecchymoses sur son visage, sur son poignet. Elle ne répondit pas. Un simple hochement de tête.
— Je vois, murmura-t-il, adoucissant sa voix.
Il nota quelques lignes, la fit signer et s’en alla.
Seule à nouveau, Anna erra dans l’appartement. Elle aurait dû pleurer, appeler, hurler. Mais elle ne ressentait qu’un vide immense, un apaisement presque coupable. Elle voulait seulement dormir. Dormir longtemps. Dormir sans peur.
Katya s’approcha, posa sa main sur sa joue.
— Maman, pourquoi tu pleures ? Papa ne reviendra plus. Il ne nous battra plus. C’est bien, non ?
— Ne dis pas ça, ma chérie, répondit Anna machinalement, d’une voix lasse. On ne parle pas ainsi de son père.
Et pourtant, au fond d’elle, elle savait : l’enfer s’était éteint. Et dans le silence du soir, elle sentit, pour la première fois, le goût fragile de la liberté.
Une agitation fébrile s’installa dès l’aube.
Anna conduisit Katya à la maternelle, puis se rendit au travail. Ses collègues savaient déjà. Les nouvelles, surtout les tragédies, circulent plus vite que les annonces officielles, et s’effacent tout aussi vite. On la regarda avec une curiosité mêlée de pitié.
Les femmes du service comptabilité, qui avaient aperçu les bleus sur ses bras, glissèrent silencieusement quelques billets dans une enveloppe. Son patron, un homme austère et peu bavard, lui remit sans un mot une avance. Ses amies la serrèrent contre elles, murmurant les phrases toutes faites qu’on réserve aux malheurs d’autrui :
— Tiens bon, Anya, tout ira bien.
— Tu es jeune, la vie ne fait que commencer.
Anna hocha la tête, mimant la douleur, tout en se reprochant intérieurement son absence de larmes, cette étrange insensibilité. En elle, il n’y avait pas de chagrin — seulement un soulagement profond, immense, presque coupable.
En se retournant, elle aperçut, immobile à l’entrée, une silhouette familière. Sa mère. Venue du lointain chef-lieu, le visage empreint d’une tristesse sincère.
— Ma pauvre fille… Comment peux-tu être seule, maintenant ?
— Pas seule, maman. Avec Katya. Et ça ne peut pas être pire, répondit Anna d’une voix ferme. Allons, monte.
Elle prit le sac posé sur le banc.
— Oh, comme c’est lourd ! Qu’as-tu apporté ?
— Il y a de la viande, murmura la mère, la voix étranglée de sanglots. Il faut organiser la veillée funèbre, recevoir…
— Maman, on ne fait plus de veillée à la maison. Tout le monde va au café, maintenant.
À peine avaient-elles franchi le seuil que le téléphone sonna. C’était son beau-père.
— Anna, la cérémonie d’adieu aura lieu demain à treize heures, au funérarium d’Oktyabrskaïa. Je cherche une salle pour le dîner commémoratif.
— Viktor Leonidovitch, répondit Anna d’une voix étonnamment calme et assurée, je vais tout organiser moi-même. Je vous appellerai ce soir pour vous dire où et combien.
Un bref silence pesa à l’autre bout du fil.
— D’accord. Pour vingt personnes. Pas plus.
— D’accord.
Elle raccrocha, puis se tourna vers sa mère.
— Maman, repose-toi. Je vais chercher une salle.
— Attends, ma fille.
Sa mère fouilla dans son vieux sac à main et en sortit quelques billets froissés.
— Prends-les. Tu en auras besoin.
Quand Anna quitta l’appartement, sa mère, suivant la vieille coutume, sortit les draps qu’elle avait apportés et couvrit tous les miroirs. Il ne fallait pas que l’âme du défunt reste prisonnière des reflets.
La salle funéraire baignait dans une lumière blafarde et crue. Le cercueil reposait au centre, ceint de couronnes. Une douzaine de personnes seulement : quelques compagnons de beuverie, des collègues de façade, quelques proches. Le prêtre psalmodiait à voix basse. Seule la mère du défunt sanglotait sans retenue.
En apercevant Anna, elle se jeta sur elle en criant d’une voix déchirée :
— C’est elle ! Elle l’a détruit ! Il était un ange, jusqu’à cette catin ! Mon fils était un souverain !
— Un ange ? répéta froidement la mère d’Anna, se dressant entre elles. Un ange qui couvrait sa femme et son enfant de bleus pendant des semaines ?
— Assez ! intervint le prêtre d’une voix ferme. On ne manque pas de respect au défunt.
— Marina, calme-toi ! tonna le beau-père.
La cérémonie et l’enterrement se déroulèrent ensuite sans incident, dans une atmosphère lourde et étouffante. Après le cimetière, chacun rentra chez soi, sauf les plus proches, réunis pour un modeste repas funèbre. On mangea en silence, sans se regarder.
De retour à l’appartement, la mère d’Anna la contempla longuement.
— Eh bien, ma fille… te voilà seule.
— Pas seule, maman. J’ai Katya. Et maintenant, j’ai une vraie vie, répondit Anna. Sa voix vibrait pour la première fois d’assurance.
— Tu te remarieras, un jour.
— Non, maman. Jamais.
Peu à peu, la vie reprit son cours. Être seule ne lui faisait plus peur — c’était même plus simple. Son salaire d’infirmière, que Sergueï gaspillait autrefois à boire, suffisait désormais pour elle et sa fille. De temps à autre, elle s’offrait de petits plaisirs : une robe pour Katya, des glaces, des livres. Elle commença à économiser pour un rêve : un chez-soi à elle, loin de ces murs saturés de souvenirs douloureux.
L’image de son mari s’effaçait lentement, se dissolvait dans le passé comme un cauchemar au matin. Oui, pensa-t-elle, il existe des cas où la mort de l’un devient le salut de l’autre. Cela leur avait rendu la vie.
Anna se consacrait à son travail et à sa fille. Elle évitait les hommes, sans haine, simplement par instinct. Jusqu’au jour où un nouveau voisin emménagea dans l’immeuble.
— Igor, dit-il en se présentant. Militaire à la retraite.
Il avait la quarantaine, l’allure droite, le regard doux. Leurs rencontres d’abord brèves — un salut, un hochement de tête — se firent plus fréquentes. Un jour, il lui porta un sac de pommes de terre jusqu’à la porte. Ils parlèrent un peu. Il vivait seul, aimait lire, cultivait des violettes.
Et puis un soir, rentrant du travail, Anna se surprit à sourire à l’idée de le croiser. Elle ajusta machinalement son rouge à lèvres devant le miroir, avant de s’arrêter, interdite. Elle n’avait pas encore trente-deux ans. La vie, enfin, recommençait.
Un an plus tard, leur appartement embaumait non seulement la soupe et les pommes au four, mais aussi les plats qu’Igor aimait préparer. Il venait souvent, apportait des fleurs, aidait Katya à faire ses devoirs, réparait les robinets.
Puis Anna partit en congé maternité — le second de sa vie. Mais cette fois, il n’y avait ni peur, ni incertitude. Seulement une attente lumineuse, joyeuse : celle d’un enfant né de l’amour.
Et ce soir-là, assise dans la cuisine claire de son nouvel appartement, serrant Igor contre elle tandis que Katya jouait avec son petit frère, Anna repensa à la tempête qui avait ravagé sa vie.
Elle avait laissé des cicatrices, certes — mais elles avaient guéri.
Et dans le silence qui emplissait la maison, elle entendait enfin le chant paisible de son propre cœur.