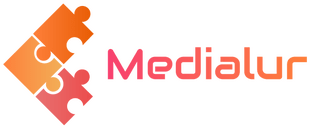La lumière d’automne, fluide et froide, inondait la table vide près de la fenêtre. Sofia Dmitrievna fit lentement glisser son doigt sur la surface lisse du registre de classe, sentant sous sa pulpe les fines éraflures laissées par des centaines de gestes semblables. Son regard revenait sans cesse à un même nom, à ces lignes soignées où, à la place des notes, s’alignait une rangée impeccable de lettres « н ». L’inquiétude sourde qu’elle ressentait depuis le matin prit peu à peu la forme nette d’une véritable angoisse.
— Marta Semionova ? — Sa voix, d’ordinaire calme, résonna un peu plus fort dans le silence qui s’était installé.
Vingt-trois paires d’yeux la fixaient avec l’attente habituelle. Mais la place du troisième rang, près de la fenêtre, restait un reproche muet. Cela faisait déjà plusieurs jours qu’elle demeurait vide, et cette absence semblait peu à peu prendre corps, devenir presque tangible.
— Quelqu’un a vu Marta cette semaine ? — demanda Sofia Dmitrievna, cherchant à croiser un regard.
Un silence embarrassé tomba sur la classe. Les élèves se dévisageaient, certains fixant obstinément leurs manuels. Finalement, Alissa, la déléguée, leva la main : une fille au regard clair et posé.
— Sofia Dmitrievna, on ne la voyait déjà pas beaucoup avant. Elle restait toujours à l’écart, dans le fond du couloir pendant les récréations.
L’enseignante hocha la tête, feignant de noter quelque chose dans le registre, mais ses pensées s’étaient déjà envolées ailleurs. Elle se rappelait la jeune fille à la voix douce et aux grands yeux étonnés, celle qui récitait sa leçon les paupières baissées, dont le sourire rare et fragile semblait se dissoudre aussitôt qu’il naissait. À la fin du cours, elle fit signe à Alissa d’approcher.
— Dis-moi, Alissa… Marta a-t-elle des amies dans la classe ? Quelqu’un avec qui elle parle ?
La jeune fille hésita un instant, traçant machinalement une ligne du doigt sur le bord de son cahier.
— Non, — répondit-elle enfin avec franchise. — Elle est toujours seule. Et le mois dernier… — elle marqua une pause. — Elle dégageait une drôle d’odeur… comme de la cave humide. Certains se moquaient d’elle à voix basse après ça.
— Ils se moquaient… — répéta doucement Sofia Dmitrievna. Quelque chose se serra douloureusement en elle, comme sous un souffle glacé.
Ce même jour, après les cours, elle monta en salle des professeurs et sortit du casier le dossier de l’élève. Le papier lui parut froid entre les doigts. L’adresse indiquait un vieux quartier à la périphérie de la ville, là où le temps semblait s’être arrêté. Elle resta longtemps immobile, le regard fixé sur un numéro de téléphone écrit d’une main étrangère ; au bout du fil, seuls répondaient des bourdonnements monotones, interminables.
Le trajet lui prit plus d’une heure. Deux bus bringuebalants, secoués par les courants d’air, la déposèrent au pied de barres d’immeubles gris, alignées comme des soldats. L’entrée d’immeuble exhalait une lourde odeur de renfermé, de poussière et de solitude. L’ascenseur ne fonctionnait plus, et elle dut grimper l’escalier, enjambant des traces de vies passées : un ticket de bus froissé, des morceaux de journaux, une chaussette d’enfant oubliée.
La porte, usée et écaillée, semblait fatiguée d’avoir trop vécu. La peinture s’en détachait par plaques, laissant apparaître d’autres couleurs, d’autres époques. Sofia Dmitrievna appuya sur la sonnette. Dans les profondeurs de l’appartement, un carillon discret retentit — un son trop solitaire, songea-t-elle.
Un homme ouvrit. Il paraissait avoir la quarantaine, mais la lassitude de son regard lui donnait dix ans de plus. Vêtu d’une robe de chambre froissée, il sentait le thé fort et la veille mal éteinte.
— C’est pour quoi faire ? — demanda-t-il d’une voix rauque, encore chargée de sommeil.
— Bonjour. Je suis la professeure principale de Marta. Sofia Dmitrievna. J’aimerais vous parler : son absence prolongée m’inquiète.
L’homme s’écarta sans un mot et lui fit signe d’entrer. L’appartement était petit, empreint de ce désordre fatigué qui trahit non la négligence, mais l’épuisement. Dans la pièce voisine, une femme était assise sur le canapé, berçant un nourrisson. Son visage pâle, creusé d’ombres violacées sous les yeux, disait des années sans sommeil.
— C’est qui, Sergueï ? — demanda-t-elle d’une voix lasse, sans lever la tête.
— L’institutrice de Marta, — répondit-il avant de s’affaler lourdement dans un fauteuil près de la télévision.
Sofia Dmitrievna s’assit prudemment sur le bord d’une chaise que la femme lui désigna d’un geste distrait.
— Marta n’est pas venue à l’école depuis un bon moment. Savez-vous ce qui lui arrive ? Est-elle malade ?
La femme ferma les yeux un instant, puis ses épaules s’affaissèrent.
— Je sais qu’elle n’est plus là. Mais où elle traîne, j’en sais rien. Avec le petit, je ne dors ni le jour ni la nuit, la maison tombe en ruine, et elle… — sa voix se brisa.
— Elle s’est encore enfuie, — coupa brutalement l’homme. — Comme d’habitude. Elle reviendra quand elle aura faim. Une vraie plaie, pas un enfant.
Un frisson glacé parcourut l’échine de l’enseignante.
— Vous voulez dire que vous ignorez où se trouve votre fille de quinze ans en ce moment même ?
— Et qu’est-ce qu’on peut y faire ? — fit Sergueï en haussant les épaules. — Elle veut vivre sa vie ? Qu’elle se débrouille.
La femme, qu’il appela Irina, se mit à pleurer doucement, serrant le bébé contre elle.
— Vous ne comprenez pas… Depuis que son père est mort, c’est comme si elle avait changé. Elle est devenue dure, fermée. Elle refuse d’aider avec le petit, ne fait plus rien à la maison. Toujours ses écouteurs dans les oreilles, ou à grattouiller sa guitare. Je n’ai plus la force de lutter.
— La guitare, c’est une passion ? — demanda doucement Sofia Dmitrievna.
— Une lubie, oui, — ricana Sergueï. — Elle ferait mieux d’étudier.
L’enseignante contempla un instant la scène : la mère épuisée, l’homme indifférent, le nourrisson fragile. Elle reconnut ce tableau trop familier : celui d’une maison où il n’y a plus de place pour un enfant de trop.
— Peut-être a-t-elle des amis, de la famille, quelqu’un chez qui elle aurait pu se réfugier ?
Irina secoua la tête, essuyant ses larmes du revers de sa manche.
— Personne. Elle ne s’attache à personne. Toujours seule.
Sofia Dmitrievna se leva et tendit sa carte.
— S’il vous plaît, si Marta revient, appelez-moi. À n’importe quelle heure. Mon numéro est dessus.
La femme prit la carte d’un geste las et la posa sur la table de nuit. Sergueï, lui, ne bougea pas, le regard perdu dans la lumière tremblotante de l’écran du téléphone.
En sortant dans la rue, Sofia Dmitrievna s’arrêta, le front appuyé contre le mur froid de l’immeuble. Sa respiration était lente, profonde — elle s’efforçait de dompter la vague de désespoir qui l’envahissait.
Elle se revit enfant : aussi seule, aussi perdue dans le vaste monde des adultes et de leurs tourments. Mais à l’époque, une main s’était tendue vers elle, juste à temps. Celle de sa première institutrice, qui avait su discerner, derrière son mutisme, la douleur, et sous sa morosité, la peur. C’est grâce à cette femme qu’elle était devenue enseignante.
Et si cette main ne s’était jamais tendue ?
Les jours suivants se fondirent en une attente longue et oppressante. Sofia Dmitrievna appelait toutes les administrations possibles, fréquentait d’innombrables bureaux, rédigeait des déclarations sans fin. Les réponses qu’elle recevait étaient polies, pleines de compassion — mais désespérément convenues.
— La jeune fille n’est plus une enfant, expliquait le policier en haussant les épaules. Elle a choisi de partir, c’est qu’elle avait ses raisons. Il y en a tant comme elle… La plupart reviennent quand la vie leur apprend la leçon.
Mais Sofia Dmitrievna refusait d’attendre.
Elle interrogeait encore et encore les camarades de classe de Marta, cherchant la moindre piste, si infime soit-elle.
Et finalement, Alissa se souvint :
— Il me semble l’avoir vue une fois, au centre-ville, près de la fontaine. Elle jouait de la guitare et chantait doucement. Je n’ai pas osé l’approcher… Elle avait l’air de ne pas vouloir être reconnue.
Le samedi matin, Sofia Dmitrievna se rendit sur la place.
C’était un lieu bruyant, grouillant de vies qui se croisaient, de joies et de détresses.
Elle fit le tour du square, scrutant les visages — musiciens, marchands, passants. Personne ne lui ressemblait. Le découragement lui serra le cœur.
Elle s’apprêtait à repartir quand une mélodie familière traversa le tumulte — cette même chanson que Marta grattait autrefois sur le rebord d’une fenêtre, entre deux cours.

La jeune fille était là, assise sur les marches de pierre, serrant contre elle une vieille guitare usée. Elle portait un manteau trop léger pour la saison et une bonnet élimé laissait échapper des mèches emmêlées. Devant elle, sur l’étui ouvert, quelques billets froissés et des pièces ternies. Elle chantait à voix basse, mais sa voix pure et claire tranchait le bruit de la ville comme une lame.
Sofia Dmitrievna s’approcha sans bruit, craignant de rompre la magie fragile de l’instant.
Lorsque la chanson prit fin, elle fit un pas.
— Bonjour, Marta.
La jeune fille sursauta, leva la tête brusquement. Dans ses yeux s’allumèrent tour à tour la peur, la honte, puis une indifférence lasse — plus terrible encore que le désespoir.
— Sofia Dmitrievna… Qu’est-ce que vous faites ici ?
— Je te cherchais. Depuis longtemps. On peut parler un peu ?
Marta ramassa rapidement l’argent et le glissa dans sa poche.
— Vous allez me ramener chez moi ? Dire à ma mère où j’étais ?
— Parlons d’abord, veux-tu ? Tu dois avoir faim. Viens, je t’offre quelque chose.
Elles s’assirent dans un petit café au coin de la rue, près d’une fenêtre.
Marta mangeait avec une avidité silencieuse qui ne laissait aucun doute : elle avait eu faim depuis plusieurs jours.
Sofia Dmitrievna la regardait, et à chaque bouchée, une douleur lourde et muette lui serrait le cœur.
— Où vis-tu, Marta ? demanda-t-elle doucement quand l’assiette fut vide.
— Chez… des amis, murmura la jeune fille sans lever les yeux.
— Marta, répondit l’enseignante en posant la main sur ses doigts glacés, tu n’as pas d’amis ici. Dis-moi la vérité.
Alors, Marta se mit à pleurer. Pas de gros sanglots, non : des larmes silencieuses qui traçaient sur sa peau sale des sillons clairs.
— Je ne peux pas y retourner… Vous ne comprenez pas… Sergeï, quand il boit, il crie… Maman a peur de lui, elle ne pense qu’au petit… Et moi, je… je gêne. Je suis en trop.
— Il te fait du mal ? demanda Sofia Dmitrievna d’une voix tremblante.
Marta hocha la tête.
— Pas toujours… Mais j’ai peur. Peur de dormir sous le même toit que lui. Et maman fait semblant de ne rien voir. C’est plus facile pour elle.
— D’accord, dit alors Sofia Dmitrievna d’un ton ferme. Écoute-moi bien.
Ce soir, tu viens chez moi. Tu prendras un bain, tu mangeras, tu dormiras au chaud, en sécurité.
Demain, on avisera ensemble.
— Chez vous ?… Je ne peux pas…
— Tu peux. Je ne te laisserai pas seule. Prends ta guitare, viens.
L’appartement de Sofia Dmitrievna était petit mais chaleureux.
Des livres alignés sur les étagères, des plantes sur le rebord de la fenêtre, un plaid doux sur le canapé.
Marta entra sur la pointe des pieds, comme si elle avait peur de troubler l’harmonie tranquille du lieu.
— La salle de bain est là, dit l’enseignante. Prends la serviette que tu veux.
Je vais te préparer le lit.
Quand Marta sortit, enveloppée dans un peignoir, les cheveux encore humides, elle paraissait plus jeune, fragile, presque enfantine.
Elles burent du thé et, peu à peu, la jeune fille parla.
De l’école, où elle se sentait invisible. Des rires des camarades qu’elle croyait dirigés contre elle. De sa mère, dont l’amour s’était, pensait-elle, dissipé à la naissance du petit frère.
— Je comprends, disait-elle. Il est petit, il a besoin d’elle. Mais moi, on ne me voit plus. J’existe, mais on ne me remarque pas. Je suis comme un fantôme chez moi.
Sofia Dmitrievna l’écoutait, le cœur serré : elle reconnaissait dans ce récit son propre passé.
— Demain, nous irons voir ta mère ensemble, dit-elle enfin. Je serai là, quoi qu’il arrive.
Le lendemain, elles se retrouvèrent devant la porte de l’appartement.
Irina ouvrit, la surprise et le soulagement se mêlant sur son visage.
— Marta ! Mon Dieu, où étais-tu ? J’étais morte d’inquiétude !
— Irina, votre fille a dormi dehors pendant deux semaines, dit calmement Sofia Dmitrievna. Elle chantait sur la place pour manger, pendant que vous… vous attendiez ici, au chaud.
Irina pâlit.
Sergeï, affalé sur un fauteuil, leva un regard sombre.
— C’est de sa faute. Qu’elle n’aille pas traîner dehors, alors.
— Taisez-vous ! lança Sofia Dmitrievna d’une voix si dure que l’homme baissa les yeux.
— Je viens proposer une solution. Marta vivra chez moi, pour un temps. Jusqu’à ce qu’on décide de la suite. Je suis prête à en assumer la garde temporaire.
— Et pourquoi donc ? grogna Sergeï, sans conviction.
— Parce qu’aucun enfant ne devrait vivre là où on lui fait du mal, là où on refuse de le voir.
Elle fixa Irina dans les yeux.
— Vous êtes sa mère. Votre devoir est de la protéger.
Irina resta muette. Du fond de l’appartement, on entendit le bébé pleurer.
— Je dois aller le calmer, murmura-t-elle en disparaissant dans la pièce voisine.
— Faites comme bon vous semble, grommela Sergeï. Emmenez votre adolescente à problèmes.
Marta serra la main de Sofia Dmitrievna avec force.
Des larmes coulaient sur son visage — des larmes de délivrance.
Elles emportèrent les quelques affaires de la jeune fille : des vêtements usés, quelques livres, la vieille guitare. Sa mère ne sortit même pas leur dire au revoir.
Les premières semaines furent silencieuses, prudentes.
Marta marchait sur la pointe des pieds, craignant de déranger, s’excusant pour tout. Elle n’était qu’une ombre, persuadée d’être un fardeau.
Mais la patience de Sofia Dmitrievna était infinie.
Elle parlait, riait, cuisinait les plats que la jeune fille aimait, sans jamais forcer la confidence.
Peu à peu, la glace se fissura. Marta recommença à sourire, à chanter.
Un soir, elle lui joua une mélodie qu’elle venait de composer — sa première.
Les démarches pour la garde prirent du temps, mais Irina ne s’y opposa pas.
Peu après, Sergeï disparut, laissant la mère seule avec son fils.
Marta reprit le chemin de l’école.
Au début, ses camarades l’observaient avec curiosité. Puis, lors de la soirée des talents, elle monta sur scène et chanta.
Le silence tomba, absolu. Puis les applaudissements éclatèrent.
Tous comprirent que la fille invisible avait un don : celui de toucher les âmes.
Les années passèrent.
Marta obtint son diplôme avec mention et entra au conservatoire.
Elle vivait désormais en internat, mais chaque week-end, chaque vacances, elle rentrait dans le petit appartement de Sofia Dmitrievna.
Elles étaient devenues une famille — non par le sang, mais par le choix.
— Vous savez, dit un soir Marta en rangeant la vaisselle, si vous ne m’aviez pas trouvée ce jour-là… je ne sais pas ce que je serais devenue.
— Tu t’en serais sortie, répondit doucement Sofia Dmitrievna. Tu es forte.
Mais même les plus forts ont parfois besoin d’une main tendue.
— Ma mère m’appelle parfois, continua Marta. Elle demande de mes nouvelles, dit qu’elle s’ennuie. On dirait qu’elle a changé.
— Les gens changent, répondit l’enseignante. Parfois, il faut perdre ce qu’on a de plus précieux pour en comprendre la valeur.
— Peut-être, murmura Marta. Mais mon foyer, maintenant, c’est ici. Avec vous. Vous êtes ma vraie famille.
Les larmes coulèrent sur les joues de Sofia Dmitrievna. Elle prit la jeune femme dans ses bras.
— Et toi, tu es ma plus grande joie. Ma fierté.
Des années plus tard, Marta était devenue une chanteuse célèbre.
Son nom brillait sur les affiches, sa voix emplissait les salles de concert.
Dans chaque interview, on lui demandait qui l’avait inspirée, qui lui avait donné la foi en elle.
— Un jour, quelqu’un est venu vers moi, disait-elle toujours.
Quelqu’un qui n’a pas vu en moi un problème, ni une adolescente perdue, mais une personne.
Elle n’est pas passée son chemin. Elle m’a tendu la main, et tout a changé.
Elle m’a appris qu’au plus profond de la nuit, il y a toujours une place pour la lumière — et que cette lumière, parfois, c’est simplement le cœur d’un être qui se soucie.
Sofia Dmitrievna, elle, continuait d’enseigner.
Chaque année, de nouveaux visages, de nouvelles histoires.
Elle scrutait les yeux de ses élèves, cherchant ceux qui cachaient la douleur derrière le silence, l’isolement sous la bravade.
Car elle savait que sa mission n’était pas seulement d’enseigner, mais de voir. D’écouter. De tendre la main.
Et dans son salon, en un endroit bien en vue, reposait un billet encadré :
le billet du tout premier concert solo de Marta.
Sur le billet, une dédicace :
> *« À la personne la plus importante de ma vie.
> Celle qui ne m’a pas seulement donné des ailes,
> mais aussi le ciel où apprendre à voler. »*
Ce n’était pas un simple souvenir.
C’était un rappel : celui qu’un seul geste, une seule preuve de bonté, peut faire naître une forêt de lumière.
Une forêt qui ne fanera jamais — parce qu’elle pousse dans la foi que chacun mérite d’être vu, entendu et aimé.